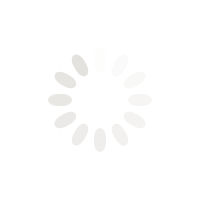Giorgos Seferis – Nobel Lecture
Discours du 11 décembre 1963
Quelques points de la tradition Grecque, moderne
Un poète qui m’est particulièrement cher, l’Irlandais Yeats, Lauréat Nobel en 1923, à son retour de Stockholm, écrivit un récit de son voyage qu’il intitula « La générosité de la Suède » – « The Bounty of Sweden «. J’y pensais, quand l’Académie Suédoise m’a fait le grand honneur de son choix. « La générosité de la Suède » est pour nous beaucoup plus ancienne, beaucoup plus étendue. Je crois qu’aucun Grec, apprenant l’hommage que vous avez rendu à ma Nation, n’a pu oublier l’effort désintéressé, patient et si parfaitement humain accompli par la Suède chez nous, soit durant la paix par vos archéologues, soit pendant la guerre par vos missions de la Croix-Rouge, et je ne mentionne pas bien d’autres gestes de solidarité, que nous voyons de nos jours.
Au moment où votre Roi, Sa Majesté Gustave VI Adolphe, me remettait le diplôme du prix Nobel, je n’ai pu moi-même m’empêcher de me rappeler avec émotion les jours où, Prince Héritier, II avait tenu à contribuer en personne aux fouilles de l’Acropole d’Asiné. Quand j’ai rencontré pour la première fois Axel Persson, cet homme au grand cour, qui s’était dévoué, lui aussi, à cette fouille, je l’avais appelé mon parrain. Mon parrain, oui, puisque Asiné m’avait fait le don d’un poème.
Dans la ville de Missolonghi, un monument de granit est dédié aux Suédois morts pour la Grèce pendant la lutte pour notre Indépendance. Notre reconnaissance est plus durable que ce granit.
Un soir, au commencement du siècle dernier, dans une rue de l’île de Zante, le poète Dionysios Solomos entendit, à la porte d’une taverne, un vieux mendiant qui récitait, en tendant la main, une ballade populaire sur l’incendie du Saint Sépulcre à Jérusalem. Le pauvre disait:
Le Saint Sépulcre du Christ, lui n’a pas brûlé;
Où va la Sainte Lumière, un autre feu ne peut aller.
Solomos, nous dit l’histoire, fut pris d’un tel enthousiasme qu’il entra dans la taverne et commanda à boire pour ceux qui s’y trouvaient. L’anecdote est très significative pour moi; je l’ai toujours considérée comme un symbole du don de la poésie que notre peuple dépose entre les mains d’un prince de l’esprit, au moment où commence la résurrection de la Grèce moderne.
Cette image représente une longue élaboration; elle n’est pas encore achevée. J’ai l’intention de vous parler de quelques hommes qui ont compté dans la lutte pour l’expression grecque, depuis que nous respirons l’air de la liberté. Pardonnez ce que mon exposé aura d’insuffisant, je ne voudrais pas abuser de votre patience.
Nos difficultés commencent à l’époque où les Alexandrins, éblouis par les chefs d’œuvre attiques, commencent à enseigner ce qu’il est correct et ce qu’il n’est pas correct d’écrire, commencent en d’autres mots à enseigner le purisme. Ils n’avaient pas compté avec le fait que la langue est un organisme vivant et que rien ne peut l’empêcher d’évoluer. D’ailleurs ils ont dû être très forts : ils ont pu engendrer des générations et des générations de puristes, qui se sont perpétués jusqu’à nos jours. Ils représentent l’un des deux grands courants de notre langue et de notre tradition, qui ne se sont jamais interrompus.
L’autre courant qui resta longtemps méprisé, c’est le courant vulgaire, populaire ou oral. Il est aussi ancien que le premier. Il ne manque pas d’ailleurs de documents écrits. J’ai été ému, le jour où il m’est arrivé de lire, conservée sur un papyrus du IIe siècle, la lettre d’un marin à son père. C’était l’actualité, la présence de cette langue qui me frappait et j’ai éprouvé de l’amertume à la pensée que pendant de longs siècles toute une foule de sentiments étaient restés inexprimés, recouverts à jamais par l’immense linceul du purisme et du beau parler rhétorique. Les Evangiles eux aussi, vous le savez, sont en langue vulgaire de l’époque. Si l’on pense aux apôtres qui ont voulu être compris et sentis par le peuple, on ne peut que considérer avec quelque peine les caprices humains qui ont fait éclater des bagarres à Athènes au commencement de ce siècle à l’occasion d’une traduction des Evangiles, et qui veulent qu’aujourd’hui encore la traduction de la parole du Christ soit illicite chez nous.
Mais j’anticipe. Ces deux courants ont poursuivi une voie parallèle jusqu’à la chute de l’Empire Grec de Byzance. D’un côté, les savants parés des mille ornements de l’esprit. De l’autre côté, le peuple, qui les regarde passer avec respect, tout en restant confiné dans ses propres modes d’expression. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu, au cours de 1’ère byzantine rapprochement des deux courants, je veux dire un phénomène, comme celui qu’on a pu observer, dans l’art des fresques et des mosaïques, quelques années avant la fin de l’empire sous les Paléologues. Alors l’art impérial et l’art populaire des provinces se sont confondus pour donner un splendide renouveau.
Cependant Constantinople agonise longtemps, avant de tomber. Quand à la fin, elle est prise, une servitude plusieurs fois séculaire recouvre toute la nation. Nombreux sont alors les savants, qui « portant de lourdes urnes remplies de la cendre des ancêtres », comme dit le poète, vont en Occident répandre les germes de ce que l’on appellera la Renaissance. Mais cette Renaissance – j’entends le terme dans son sens strict, quand nous employons ce mot pour indiquer le passage du Moyen-Age aux Temps Modernes – nous ne l’avons pas connue, pour notre bien ou notre mal. Il y a une exception : celle de certaines îles, la Crète principalement. L’île vivait alors sous la domination des Vénitiens. Là, vers le XVIe siècle, on voit s’élaborer une poésie et un théâtre en vers, dans une langue splendidement vivante, parfaitement sûre d’elle-même. Si l’on pense qu’à cette même époque, d’importants ateliers de peinture florissaient dans l’île et qu’en même temps, vers le milieu du siècle, naît et grandit le grand peintre crétois Domenicos Theotocopoulos, qui sera dit el Greco, on éprouvera plus de peine pour la chute de la Crète que pour la chute de Constantinople.
Car, enfin, Constantinople était un organisme qui avait déjà reçu un coup mortel, porté en 1204 par les Croisés. Il se survivait. La Crète au contraire était dans toute sa vigueur. Et l’on ne peut que se pencher avec un étrange sentiment d’amertume et de foi, sur le destin de cette terre grecque dont les hommes préparent toujours un renouveau que viennent dilapider les rafales de l’histoire. On songe au mot que le poète Calvos écrivit au Général Lafayette: « Dieu et notre désespoir ».
De toute façon ce renouveau de la Crète s’émiette vers le milieu du XVIIe siècle. En ce temps-là, beaucoup de Cretois se réfugièrent dans les îles Ioniennes et dans d’autres parties de la Grèce. Ils transportaient avec eux leurs poèmes, qu’ils savaient déjà par cour, et qui furent immédiatement adoptés dans leurs nouveaux foyers. Ils s’unirent parfois avec les chants populaires, les chants que les hommes de la Grèce continentale avaient conservés avec leurs légendes pendant de longues générations. Il y a des signes qui font penser que certains d’entre eux remontent aux temps du paganisme; d’autres apparaissent au cours des siècles, tel le cycle de Digénis Akritas, issu de l’époque byzantine. Ils nous font voir qu’à travers les âges les mêmes attitudes devant le travail et la peine, la joie, l’amour et la mort se sont répétées sans cesse. Mais, en même temps, ils ont des expressions si fraîches, si libres et une mesure si humaine qu’ils nous font toucher du doigt combien l’esprit du Grec reste toujours pareil à lui-même. J’ai évité jusqu’à présent de vous donner des exemples. Bien que je sois immensément redevable à mes traducteurs – c’est grâce à eux que vous avez pu me connaître – j’ai le pénible sentiment de déformer irrémédiablement en traduisant ma langue dans une langue qui n’est pas la mienne. Excusez-moi, si je ne puis en ce moment m’empêcher de faire une exception. C’est un très court poème; il s’agit de la mort d’un être aimé:
Moi, pour te garder, j’ai placé trois sentinelles:
le soleil sur la montagne, l’aigle sur la plaine,
et le vent frais du nord je l’avais aux navires.
Le soleil s’est couché, l’aigle s’est endormi,
et le vent frais du nord l’ont emporté les navires.
Charon trouva l’occasion bonne et te prit.
Je vous ai donné un pâle reflet du poème, mais en grec il va loin.
Voilà en termes très simplifiés les antécédents. C’est le patrimoine que le vieux mendiant, un soir, devant une taverne de Zante remit à Dionysios Solomos. Cette image me vient à l’esprit toutes les fois que je pense à lui et à ce qu’il nous a donné.
Dans l’histoire de la poésie grecque de notre temps, les figures et les cas étranges ne manquent pas. Il était, par exemple, bien plus naturel, j’imagine, que la poésie d’un peuple marin, agricole et guerrier, commençât par un chantre de sentiments frustes et simples. C’est le contraire qui arriva. Elle devait commencer par un homme, que possédait le démon de l’absolu. Il est né dans l’île de Zante. Il me faut remarquer immédiatement que le niveau de culture des îles Ioniennes était, à cette époque, de beaucoup supérieur à celui de la Grèce continentale. Solomos avait fait ses études en Italie. C’était un grand Européen, très averti des problèmes qu’affrontait la poésie de son siècle. Il pouvait se faire une carrière en Italie, il écrivit des poèmes italiens; les encouragements ne lui firent pas défaut. Il préféra la porte étroite: il décida de faire son ouvre en grec. Solomos avait certainement connu les poèmes que les réfugiés crétois avaient apporté avec eux. C’était un partisan fervent de la langue du peuple et un ennemi du purisme. Ses vues sur ce problème nous ont été conservées dans son Dialogue du Poète et du Lettré pédant (il faut entendre ce mot dans le sens où Rabelais emploie le mot Sorbonicole). Je cite au hasard: «Ai-je autre chose dans mon esprit», s’écrie-t-il, « que la liberté et la langue ? », ou encore : « Soumets-toi à la langue du peuple, et si tu es assez fort, conquiers-la. » C’est cette conquête qu’il entreprit et c’est par cette entreprise qu’il devint un grand Grec. Solomos est sans doute l’auteur de l’Hymne à la liberté, dont les premiers vers constituent notre hymne national, et d’autres poèmes qui ont été mis en musique et abondamment chantés au cours du siècle dernier. Ce n’est pourtant pas à cause de cela que son héritage compte pour nous; c’est parce qu’il a su tracer d’une manière aussi définitive que son temps le lui permettait, le chemin que devait prendre l’expression grecque. Il aima la langue vivante et travailla toute sa vie pour l’élever au niveau de la poésie dont il rêvait. C’était un effort qui dépassait les forces d’un seul homme. De ses grands poèmes, par exemple Les assiégés libres, inspiré par le siège et les souffrances de la ville de Missolonghi, il ne nous reste que des fragments, la poussière d’un diamant emporté par l’ouvrier dans la tombe. Il ne nous reste que des fragments et des blancs qui représentent la lutte de cette grande âme tendue comme la corde d’un arc qui devait se briser. De nombreuses générations d’écrivains grecs allaient se pencher sur ces fragments et sur ces blancs. Solomos meurt en 1857. En 1927 on publie pour la première fois La Femme de Zante, qui le consacre grand prosateur, comme il avait été consacré, depuis longtemps, grand poète. C’est un texte manifique qui fait une profonde incision dans nos esprits. De façon significative, le destin voulut que Solomos, soixante-dix ans après sa mort, répondît par ce message aux inquiétudes des nouvelles générations. Il a toujours été un commencement.
André Galvos est un contemporain de Solomos et une des figures les plus isolées de la littérature grecque. Nous n’avons pas même un portrait de lui. Ami de Ugo Foscolo, le poète italien, il a tôt fait de se brouiller avec lui. Né dans l’île de Zante et ayant vécu de longues années à Corfou, il ne semble avoir eu aucun contact avec Solomos. Un mince volume de vingt odes, qu’il publie ayant à peine dépassé la trentaine, constitue toute son ouvre. Dans sa jeunesse il a beaucoup voyagé: Italie, Suisse, Angleterre. C’est un homme altier, imbu des idées morales de la fin du XVIIIe siècle, voué à la vertu, haïssant la tyrannie. Sa poésie est inspirée de la grandeur et de la douleur d’un pays martyr. On est ému, quand on s’aperçoit que cet homme, qui a été privé de sa mère dans son enfance, identifie dans les profondeurs de sa conscience l’amour de la mère perdue et celui de la patrie. Sa langue est irrégulière, ses rythmes sont personnels; il a devant lui un idéal classique; il dédaigne ce qu’il appelle la « monotonie des poèmes crétois », qui avaient tant donné à Solomos. Mais il a des images fulgurantes et tellement immédiates qu’elles semblent, pour ainsi dire, déchirer son vers. Après une vie solitaire à Corfou, consacrée à l’enseignement, il quitte définitivement les îles Ioniennes. Il se marie une deuxième fois à Londres et va avec sa femme ouvrir un pensionnat de jeunes filles dans une petite ville de la province anglaise. Il y reste pendant 14 ans, jusqu’à sa mort, sans donner signe de vie à la Grèce. J’ai pu faire un pèlerinage dans ces régions, que hante l’ombre de Tennyson. Un vieillard qui aimait ce pays m’a raconté qu’il avait interrogé autrefois de vieilles femmes, octogénaires, qui avaient été des élèves de Calvos; leurs souvenirs étaient pleins de respect pour leur ancien maître. Mais là encore je n’ai pu me libérer de l’image de cet homme sans visage, vêtu de noir, frappant sa lyre, sur un promontoire isolé. Son ouvre tombe dans l’oubli. Sans doute, sa voix n’était pas conforme au goût de la rhétorique irréelle et romantique, qui sévissait à Athènes à l’époque. Il fut redécouvert vers les années 1890 par Kostis Palamas. On avait mûri entre temps. Ce sont les années où les jeunes forces de la Grèce moderne commencent à éclater. C’est l’heure où la lutte pour la langue vivante prend de l’ampleur. Elle n’alla pas sans exagérations, c’était d’ailleurs naturel. Cette lutte se poursuivit bien des années après. Elle dépasse la littérature. Elle est caractérisée par la volonté d’affronter le présent dans tous les domaines. Elle se tourne avec ferveur vers l’instruction publique. Elle rejette les formes et les idées toutes faites. Elle entend certainement préserver le patrimoine des anciens, mais en même temps elle se tourne vers le peuple; elle veut éclairer l’un par l’autre. Elle se demande ce que nous sommes, nous, maintenant. Des savants et des maîtres d’école y participent. C’est le moment où voient le jour d’importants travaux sur le folklore grec, et recommence à s’établir la conscience de la continuité de notre tradition orale et de la nécessité de l’esprit critique.
Kostis Palamas joue un très grand rôle dans ce mouvement. J’étais adolescent, quand je l’ai vu pour la première fois; il faisait une conférence. C’était un homme de très petite taille; il impressionnait par la profondeur de ses yeux et de sa voix, riche avec quelque chose de brisé dans le fond. Son ouvre est immense; elle couvre de son ombre des décades de la vie littéraire grecque. Il s’est exprimé dans tous les genres de la poésie, lyrique, épique, satirique; il est en même temps notre critique le plus important. Il avait une connaissance étonnante des littératures étrangères, montrant, une fois de plus, que la Grèce est un carrefour et que depuis Hérodote ou Platon, elle n’a jamais été fermée aux courants étrangers, particulièrement dans ses meilleurs moments. Palamas a eu, inévitablement, des ennemis, souvent parmi ceux qui avaient profité du chemin qu’il avait ouvert. Je le considère comme une force de la nature, devant laquelle la critique apparaît mesquine. C’est comme si une force refoulée et accumulée pendant plus de mille années de purisme avait enfin rompu ses digues. Quand les eaux se libèrent pour inonder une plaine assoiffée, on ne peut pas demander qu’elles charrient seulement des fleurs. Palamas avait une conscience profonde de tous les recoins de notre tradition, antique, byzantine, moderne. Tout un monde de choses inexprimées se pressait dans son âme. C’est ce monde, le sien, qu’il a libéré. Je ne veux pas soutenir que son abondance ne lui ait pas nui, mais le peuple qui s’était rassemblé autour de son cercueil en 1943, avait certainement senti quelque chose de ce que je viens de vous dire, quand à l’instant du dernier adieu, il entonna, spontanément, sous les yeux des autorités d’occupation, notre hymne national, l’hymne à la liberté.
Cent cinquante quatre poèmes constituent l’ouvre reconnue de Constantin Cavafis, qui se situe aux antipodes de Palamas. C’est un rare cas de poète, dont la force motrice n’est pas le verbe; l’abondance de la parole est son danger. Il appartenait à cet hellénisme florissant de l’Egypte, aujourd’hui en voie de disparition. A part de rares absences, il a passé toute sa vie à Alexandrie, sa ville natale. Ce qui caractérise son art, ce sont ses refus. C’est aussi son sens de l’histoire. Je n’entends pas l’histoire comme récit du passé; j’entends l’histoire qui vit dans le présent, qui éclaire notre vie présente, son drame et sa fatalité. Je l’ai comparé à ce Protée du littoral alexandrin, dont Homère nous dit qu’il changeait sans cesse de formes. Sa tradition n’est pas la tradition populaire que Solomos ou Palamas ont exprimée, c’est la tradition savante. Là où ceux-ci s’inspirent d’une chanson ou d’une légende populaire, il aura recours à Plutarque, ou à un obscur chronographe ou encore aux faits et gestes d’un Ptoléméc ou d’un Séleucide. Sa langue est un composé fait de ce que lui avait transmis une bonne famille de Constantinople, sa famille, et de ce que son oreille surprenait dans les rues d’Alexandrie – c’est un homme de la ville. Il aime les pays et les époques où les frontières ne sont pas bien définies, où les caractères et les croyances sont fluides. Beaucoup de ses personnages sont en partie païens et en partie chrétiens, ou vivent parmi une population très mélangée – « Syriens, Grecs, Arméniens, Mèdes » – comme il a dit. Quand on a acquis quelque familiarité avec sa poésie, il arrive que l’on se demande s’il ne s’agit pas d’une projection de notre vie présente dans le passé, ou bien si l’histoire n’a pas décidé tout d’un coup d’envahir notre existence actuelle. Son monde est un monde liminaire qui revient à la vie par la grâce d’un jeune corps. Son ami E. M. Forster m’a raconté que le jour où il lui récita pour la première fois une traduction de ses poèmes, Kavafis surpris, s’exclama: «But you understand, my dear Forster, you understand! » – « Mais alors, vous comprenez, mon cher Forster, vous comprenez !». Tant nous avions perdu l’habitude d’être compris.
Le temps a passé depuis et Kavafis a été abondamment traduit et commenté; je pense en ce moment au pur poète et au généreux helléniste qu’était votre Hjalmar Gullberg, qui a présenté Kavafis en Suède. Mais la Grèce a plusieurs aspects; tous ne sont pas d’abord facile. Je songe au poète Ange Sikélianos. Lui, je l’ai bien connu. On n’oubile pas facilement sa grande voix quand il récitait ses vers. Il avait quelque chose de la magnificence d’un barde d’un autre temps, mais en même temps une familiarité peu commune avec notre terre et les gens de la campagne. Tous l’aimaient. Ils l’appelaient simplement « Anghelos », comme s’il était l’un des leurs. Il savait relier tout naturellement les paroles et le comportement d’un berger du Parnasse ou d’une villageoise avec le monde sacré qu’il habitait. Un dieu le possédait, une force faite d’Apollon, de Dionysos et du Christ. Un de ses poèmes, écrit une nuit de Noël, pendant la dernière guerre, est intitulé: « Dionysos au berceau ». Il commence :
Mon doux enfant, mon Dionysos et mon Christ.
Et en vérité c’est chose étonnante que d’observer comment la vieille religion païenne est venue s’unir en Grèce avec notre Orthodoxie Chrétienne. En Grèce, Dionysos fut, lui aussi, un dieu crucifié. Cet homme qui a senti et appelé si fort la résurrection de l’homme et du monde est cependant le même qui a dit : « la seule méthode est la mort ». Il avait compris que vie et mort sont les deux faces d’une même chose. J’allais le voir, chaque fois que je passais par la Grèce. Il souffrait d’une longue maladie, mais la force qui l’inspirait ne l’a jamais quitté, jusqu’au bout. Un soir, chez lui, après un évanouissement qui nous avait inquiété, il m’a dit: « J’ai vu le noir absolu, il était indiciblement beau ».
Maintenant je voudrais terminer ce court exposé avec un homme que j’ai toujours gardé près de moi; il m’a soutenu dans des heures difficiles, où toute ressource semblait perdue. Dans ce pays de contrastes qui est le mien, il est un cas extrême. Ce n’est pas un intellectuel. Mais l’intellect réduit à lui-même a parfois besoin de fraîcheur, comme les morts qui réclament du sang frais avant de répondre à Ulysse. Il avait appris à lire et à écrire un peu, à l’âge de trente-cinq ans, afin de pouvoir raconter, dit-il, ce qu’il avait vu pendant la guerre de l’indépendance, où il avait pris une part très active. Il s’appelle Jean Makriyannis. Je le compare à un de ces vieux troncs d’olivier de chez nous, façonnés par les éléments et qui peuvent, je crois, enseigner la sagesse. Lui aussi a été façonné par les éléments humains, par bien des générations d’âmes humaines. Il était né, vers la fin du XVIIIe siècle, dans la Grèce continentale, près de Delphes. Il nous raconte comment sa pauvre mère allant ramasser des fagots, avait été prise des douleurs de l’enfantement et lui donna naissance dans un bois. Ce n’est pas un poète, niais le chant est en lui, comme il a toujours été dans l’âme du peuple. Quand un étranger, un Français, lui rend visite, il l’invite à table : « Mon hôte », raconte-t-il, « voulait aussi entendre de nos chants; je lui en ai fabriqué quelques uns ». Il est doué d’une force d’expression singulière; son écriture fait penser à un mur que l’on bâtit pierre à pierre; tous ses mots fonctionnent et ont des racines; il a parfois des mouvements de style homériques. C’est l’homme qui m’a le plus enseigné en matière de prose. Il n’aime pas les faux semblants de la rhétorique. Dans un moment de colère, il s’écrie: « Et vous avez nommé un nouveau chef à la citadelle de Corinthe, un pédant! Son nom était Achille et en entendant le nom d’Achille, vous avez cru qu’il s’agissait de l’illustre Achille et que le nom allait combattre. Ce n’est jamais le nom qui combat; ce qui combat, c’est la valeur, l’amour de la patrie, le vertu ». Mais en même temps, l’on comprend l’amour qu’il a du patrimoine antique, quand, à des soldats qui veulent vendre deux statues à des étrangers, il dit: « Même si l’on vous paye dix mille thalers, n’acceptez pas qu’elles quittent notre sol. C’est pour elles que nous nous sommes battus ». Quand on songe que la guerre avait laissé de nombreuses plaies sur le corps de cet homme, on a le droit de conclure que ces paroles ont quelque poids. Vers la fin de sa vie, son destin devient tragique. Ses plaies lui donnent des souffrances intolérables. Il est persécuté, jeté en prison, jugé et condamné. Dans son désespoir, il écrit des lettres à Dieu : « Et tu ne nous entends pas, tu ne nous vois pas …» C’est la fin. Makriyannis est mort vers le milieu du siècle dernier. Ses Mémoires ont été déchiffrés et publiés en 1907. Il fallut bien des années encore pour que les jeunes prissent conscience de sa véritable envergure.
Je vous ai parlé de ces hommes, parce que leurs ombres n’ont pas cessé de m’accompagner depuis que mon voyage pour la Suède a commencé et parce que leurs efforts représentent dans mon esprit les efforts d’un corps ligoté pendant des siècles, lorsque ses liens se trouvant enfin rompus il reprend vie, tâtonne et recherche ses mouvements naturels. Mon exposé a sans doute plusieurs défauts. Le défaut de la simplification, qui déforme. Le défaut, que je n’aime pas, d’une chose personnelle. J’ai omis certainement de très grandes figures. Par exemple celles d’Adamandios Korais ou d’Alexandre Papadiamandis. Mais comment parler si l’on ne se décide au choix? Excusez-moi, si j’ai péché. D’ailleurs je n’ai fait qu’indiquer, aussi simplement que possible, quelques jalons. Tout autour d’eux et dans le temps qui sépare ces hommes, il y a, bien entendu, de nombreuses générations de travailleurs, qui ont peiné et sacrifié leur vie pour faire avancer l’esprit un peu plus près de cette expression aux multiples visages qu’est l’expression grecque. J’ai voulu aussi exprimer ma solidarité avec mon peuple. Non seulement avec les grands maîtres de l’esprit, mais avec les inconnus, les ignorés, ceux même qui se sont penchés sur un seul livre avec la même ferveur que l’on se penche sur une icône; avec les enfants, qui faisaient des heures de marche pour aller à des écoles éloignées de leur village, « pour apprendre les lettres, les choses du bon dieu », comme dit leur chanson. Pour rappeler encore une fois mon ami Makriyannis, « il ne faut pas dire moi, mais il faut dire nous », car personne n’achève rien tout seul. Je trouve qu’il est bien qu’il en soit ainsi. J’ai besoin de cette solidarité, parce que si je ne comprends pas les hommes de chez nous, avec leurs vertus et leurs vices, je sens que je ne pourrai pas comprendre les autres hommes de par le grand monde. Je ne vous ai pas parlé des anciens. Je n’ai pas voulu vous fatiguer. Peut-être dois-je ajouter quelques mots. Depuis le XVe siècle, depuis la chute de Byzance, ils deviennent de plus en plus le patrimoine de l’humanité. Ils sont pétris dans ce que nous appelons – par raccourci – civilisation européenne. Nous nous réjouissons que tant de nations contribuent à les rendre plus proches de notre vie. Quant à nous, il nous reste tout de même certaines choses inaliénables. Si je m’observe lisant dans Homère ces simples mots : daoz helioio – je dis aujourd’hui : « dwz tou hliou » – « la lumière du soleil » – j’éprouve une familiarité qui s’apparente plutôt à une psyché collective qu’à un effort du savoir. C’est une note, pour ainsi dire, dont les harmoniques s’étendent bien loin; cela est d’un toucher bien différent de ce que peut donner une traduction. Car enfin nous parlons la même langue – et le sentiment d’une langue relève aussi bien de l’émotion que du savoir. Une langue altérée, si vous voulez, par une évolution plusieurs fois millénaire, mais malgré tout fidèle à elle-même. Elle porte les empreintes de gestes et d’attitudes répétés à travers les âges jusqu’à nous, et qui simplifient parfois d’une mainière étonnante des problèmes d’interprétation, qui paraissent à d’autres bien difficiles. Je ne dirai pas que nous sommes du même sang – car j’ai horreur des théories raciales – mais nous habitons toujours ce même pays et nous regardons les mêmes montagnes finir dans la mer. Peut-être ai-je employé le mot de tradition, sans souligner cette évidence que tradition ne signifie pas habitude. Elle intéresse au contraire par la faculté de pouvoir rompre l’habitude; c’est par cela qu’elle prouve sa force de vie.
Je ne vous ai pas parlé non plus de ma propre génération, de cette génération sur laquelle est tombé le lourd fardeau d’une réadaptation morale après l’exode d’un million et demi d’âmes de l’Asie Mineure, et qui a été le témoin d’un phénomène unique dans l’histoire grecque, le reflux sur le sol de la Grèce, la polarisation de nos populations dispersées à travers le monde dans des centres florissants.
Enfin je ne vous ai pas parlé de la génération, qui est venue après nous, de celle dont l’enfance et l’adolescence ont été meurtries pendant les années de la dernière guerre. Elle a sans doute de nouveaux problèmes et d’autres points de vue: la Grèce s’industrialise de plus en plus. Les nations se rapprochent toujours davantage. Le monde change. Ses mouvements vont en s’accélérant. On dirait que le propre du monde actuel est de désigner des abîmes soit dans l’âme humaine, soit dans l’univers qui nous entoure. La notion de la durée a changé. C’est une jeunesse douloureuse et inquiète. Je ressens ses difficultés, qui ne sont pas d’ailleurs bien éloignées des nôtres. Un grand ouvrier de notre liberté, Righas Phéraios, enseignait: « Qui pense librement, pense bien ». Je voudrais souhaiter d’ici à notre jeunesse de songer en même temps à l’adage gravé sur le linteau de la porte de votre Université d’Uppsala: « Penser librement est bien, penser juste est mieux ».
J’en ai terminé. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie aussi de ce que « la générosité de la Suède » me permet enfin de me sentir personne, j’entends ce terme dans le sens que lui donnait Ulysse, guand il répondait au Cyclope Polyphème : « outiz » – personne, dans ce mysterieux courant : la Grèce.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.