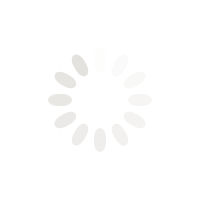Orhan Pamuk – Conférence Nobel
English
Swedish
French
German
Turkish
Le 7 décembre 2006
La valise de mon papa
Deux ans avant sa mort, mon père m’a remis une petite valise remplie de ses propres écrits, ses manuscrits et ses cahiers. En prenant son habituel air sarcastique, il m’a dit qu’il voulait que je les lise après lui, c’est-à-dire après sa mort.
« Jette un coup d’œil », a-t-il dit, un peu gêné, « peut-être y a-t-il quelque chose de publiable. Tu pourras choisir ».
On était dans mon bureau, entourés de livres. Mon père s’est promené dans le bureau en regardant autour de lui, comme quelqu’un qui cherche à se débarrasser d’une valise lourde et encombrante, sans savoir où la poser. Finalement, il l’a posée discrètement, sans bruit, dans un coin. Une fois passé ce moment un peu honteux mais inoubliable, nous avons repris la légèreté tranquille de nos rôles habituels, nos personnalités sarcastiques et désinvoltes. Comme d’habitude, nous avons parlé de choses sans importance, de la vie, des inépuisables sujets politiques de la Turquie, de tous ses projets inaboutis, d’affaires sans conséquences.
Je me souviens d’avoir tourné autour de cette valise pendant quelques jours après son départ, sans la toucher. Je connaissais depuis mon enfance cette petite valise de marocain noir, sa serrure, ses renforts cabossés. Mon père s’en servait pour ses voyages de courte durée, et parfois aussi pour transporter des documents de chez lui à son travail. Je me rappelais avoir, enfant, ouvert cette valise et fouillé dans ses affaires, d’où montait une odeur délicieuse d’eau de Cologne et de pays étrangers. Cette valise représentait pour moi beaucoup de choses familières ou fascinantes, de mon passé, et de mes souvenirs d’enfance ; pourtant, je ne parvenais pas à la toucher. Pourquoi ? Sans doute à cause du poids énorme et mystérieux qu’elle semblait renfermer.
Je vais parler maintenant du sens de ce poids : c’est le sens du travail de l’homme qui s’enferme dans une chambre, qui, assis à une table ou dans un coin, s’exprime par le moyen du papier et d’un stylo, c’est-à-dire le sens de la littérature.
Je n’arrivais pas à prendre et à ouvrir la valise de mon père, mais je connaissais certains des cahiers qui s’y trouvaient. J’avais déjà vu mon père écrire dessus. Ce n’étais pas la première fois que je ressentais tout le poids contenu dans cette valise. Mon père avait une grande bibliothèque ; dans sa jeunesse, à la fin des années quarante, il avait voulu devenir poète, à Istanbul, il avait traduit Valéry en turc, mais n’avait pas voulu s’exposer aux difficultés d’une vie consacrée à la poésie dans un pays pauvre, où les lecteurs étaient bien peu nombreux. Son père – mon grand-père – était un riche entrepreneur, mon père avait eu une enfance facile, il ne voulait pas se fatiguer pour la littérature. Il aimait la vie et ses agréments, et je le comprenais.
Ce qui me retenait tout d’abord de m’approcher de la valise de mon père, c’était la crainte de ne pas aimer ce qu’il avait écrit. Il s’en doutait sûrement, et avait d’ailleurs pris les devant en affectant une espèce de désinvolture à l’égard de cette valise. Cette attitude m’affligeait, moi qui écrivais depuis vingt-cinq ans, mais je ne voulais en tenir rigueur à mon père de ne pas prendre la littérature suffisamment au sérieux… Ma vrai crainte, la chose qui m’effrayait vraiment, c’était la possibilité que mon père eût été un bon écrivain. C’est en fait cette peur qui m’empêchait d’ouvrir la valise de mon père. Et je n’arrivais même pas à m’avouer cette vraie raison. Car si de sa valise était sortie une grande œuvre, j’aurais dû reconnaître l’existence d’un autre homme, totalement différent, à l’intérieur de mon père. C’était quelque chose d’effrayant. Même à mon âge déjà avancé, je tenais à ce que mon père ne fût que mon père, et non un écrivain.
Pour moi, être écrivain, c’est découvrir patiemment, au fil des années, la seconde personne, cachée, qui vit en nous, et un monde qui secrète notre seconde vie : l’écriture m’évoque en premier lieu, non pas les romans, la poésie, la tradition littéraire, mais l’homme qui, enfermé dans une chambre, se replie sur lui-même, seul avec les mots, et jette, ce faisant, les fondations d’un nouveau monde. Cet homme, ou cette femme, peut utiliser une machine à écrire, s’aider d’un ordinateur, ou bien, comme moi, peut passer trente ans à écrire au stylo et sur du papier. En écrivant, il peut fumer, boire du café ou du thé. De temps en temps il peut jeter un coup d’œil dehors, par la fenêtre, sur les enfants qui s’amusent dans la rue – s’il a cette chance, sur des arbres, un paysage – ou bien sur un mur aveugle. Il peut écrire de la poésie, du théâtre ou comme moi des romans. Toutes ces variations sont secondaires par rapport à l’acte essentiel de s’asseoir à une table, et de se plonger en soi-même. Ecrire, c’est traduire en mots ce regard intérieur, passer à l’intérieur de soi, et jouir du bonheur d’explorer patiemment, et obstinément, un monde nouveau. Au fur et à mesure qu’assis à ma table, j’ajoutais mot après mot sur des feuilles blanches, et que passaient les jours, les mois, les années, je me sentais bâtir ce nouveau monde, comme on bâtit un pont, ou une voûte, et découvrir en moi comme une autre personne. Les mots pour nous, écrivains, sont les pierres dont nous nous bâtissons. C’est en les maniant, en les évaluant les uns par rapport aux autres, en jaugeant parfois de loin, parfois au contraire en les pesant et en les caressant du bout des doigts et du stylo que nous les mettons chacun à sa place, pour construire à longueur d’année, sans perdre espoir, obstinément, patiemment.
Pour moi le secret du métier d’écrivain réside non pas dans une inspiration d’origine inconnue mais sur l’obstination et la patience. Une jolie expression turque « creuser un puits avec une aiguille », me semble avoir été inventée pour nous autres écrivains. J’aime et je comprends la patience de Farhad qui selon la légende perça les montagnes pour l’amour de Shirine. En parlant dans Mon Nom est Rouge, des miniaturistes Persans qui à force de dessiner toujours le même cheval, pendant des années, finissent par le mémoriser au point de pouvoir l’exécuter les yeux fermés, je savais que je parlais aussi du métier d’écrivain, et de ma propre vie. Il me semble que, pour être en mesure de narrer sa propre vie comme l’histoire des autres, et de puiser en lui-même ce don de raconter, l’écrivain doit lui-même, avec optimisme, faire le don de toutes ces années à son art et à son métier. La muse, qui ne rend visite qu’à certains, et jamais aux autres, est sensible à cette confiance, à cet optimisme, et c’est quand l’écrivain se sent le plus seul, quand il doute le plus de la valeur de ses efforts, de ses rêves et de ce qu’il a écrit – c’est-à-dire quand il croit que son histoire n’est rien d’autre que son histoire, que la muse vient lui offrir les histoires, les images et les rêves qui le monde où il vit et le monde qu’il veut bâtir. Le sentiment le plus bouleversant pour moi dans ce métier d’écrivain auquel j’ai donné toute ma vie, a été de penser parfois que certaines phrases, certaines pages qui m’ont rendu infiniment heureux m’étaient révélées par la grâce d’une puissance extérieure.
J’avais peur d’ouvrir la valise de mon père et de lire ses cahiers parce que je savais qu’il ne se serait jamais exposé aux difficultés que j’ai eu moi-même à affronter. Il aimait non la solitude, mais les amis, les pièces bondées, les plaisanteries en société. Mais ensuite, je fis un autre raisonnement : la patience, l’ascétisme, toutes ces conceptions que j’avais échafaudées pouvaient n’être que mes propres préjugés, liés à mon expérience personnelle et à ma vie d’écrivain. Les auteurs géniaux ne manquaient pas, qui écrivirent au milieu d’une vie brillante, bruyante, avec une existence sociale ou familiale heureuse et intense. De plus, notre père nous avait abandonnés, enfants, pour fuir justement la médiocrité de sa vie familiale. Il était parti à Paris, où il avait, comme beaucoup d’autres, rempli des cahiers dans des chambres d’hôtel. Je savais que dans la valise se trouvait une partie de ces cahiers, car pendant les années qui précédèrent la remise de cette valise, mon père avait commencé à me parler de cette période de sa vie. Dans notre enfance aussi il parlait de ces années-là, mais sans évoquer sa propre fragilité, ni son désir de devenir poète, ni ses angoisses existentielles dans des chambres d’hôtel. Il racontait comment il voyait souvent Sartre sur les trottoirs de Paris, il parlait des livres qu’il avait lus et des films qu’il avait vus avec un enthousiasme naïf, comme quelqu’un qui apporte des nouvelles importantes. Je ne pouvais certainement pas me dissimuler ce que ma destinée d’écrivain devait au fait que mon père parlait bien plus souvent des grands auteurs de la littérature mondiale que de nos pachas ou auteurs religieux. Peut-être fallait-il plutôt, au lieu d’attacher trop d’importance à la valeur littéraire de ses écrits, aborder les cahiers de mon père en considérant tout ce que je devais aux livres de sa bibliothèque, en me rappelant que mon père, quand il vivait avec nous, n’aspirait lui aussi, comme moi, qu’à se retrouver seul dans une chambre, pour se frotter à la foule de ses rêves.
Cependant, en contemplant avec inquiétude cette valise fermée, je me sentais justement incapable de cela-même. Mon père avait coutume, parfois, de s’allonger sur le sofa à l’entrée de sa bibliothèque, de poser le magazine ou le livre qu’il était en train de lire, et de suivre longuement le cours de ses pensées. Sur son visage apparaissait alors une nouvelle expression, différente de celle qu’il avait en famille, au milieu des plaisanteries, des disputes ou des taquineries – un regard tourné vers l’intérieur. J’en avais déduit dès mon enfance et ma première jeunesse que mon père était un homme inquiet, et je m’en inquiétais. Je sais maintenant, tant d’années après, que cette inquiétude est l’une des raisons qui font d’un homme un écrivain. Pour devenir écrivain, il faut avoir, avant la patience et le goût des privations, un instinct de fuir la foule, la société, la vie ordinaire, les choses quotidiennes partagées par tout le monde, et de s’enfermer dans une chambre. Nous, écrivains, avons besoin de la patience et de l’espérance pour rechercher les fondements, en nous-mêmes, du monde que nous créons, mais le besoin de nous enfermer dans une chambre, une chambre pleine de livres, est la première chose qui nous motive. Celui qui marque le début de la littérature moderne, le premier grand exemple d’écrivain libre et de lecteur affranchi des contraintes et des préjugés, qui a le premier discuté les mots des autres sans rien écouter que sa propre conscience, qui a fondé son monde sur son dialogue avec les autres livres, est évidemment Montaigne. Montaigne est un des écrivains à la lecture desquels mon père revenait sans cesse et m’incitait toujours. Je veux me considérer comme appartenant à cette tradition d’écrivains qui, que ce soit en Orient ou en Occident, se démarquent de la société, quelle qu’elle soit, où ils vivent, pour s’enfermer dans une chambre pleine de livres. Pour moi , l’homme dans sa bibliothèque est le lieu où se fonde la vraie littérature.
Pour autant, notre solitude dans cette chambre où nous nous enfermons n’est pas si grande que nous le croyons. Nous sommes environnés des mots, des histoires des autres, de leurs livres, de tout ce que nous appelons la tradition littéraire. Je crois que la littérature est la somme la plus précieuse que l’humanité s’est donnée pour se comprendre. Les sociétés humaines, les tribus et les nations deviennent intelligentes, s’enrichissent et s’élèvent dans la mesure où ils prennent au sérieux leur littérature, où ils écoutent leurs écrivains, et comme nous le savons tous, les bûchers de livres, les persécutions contre les écrivains présagent pour les nations de périodes noires et obscures. La littérature n’est jamais seulement un sujet national ; l’écrivain qui s’enferme dans une chambre avec ses livres, et qui initie avant tout un voyage intérieur va y découvrir au cours des années cette règle essentielle : la littérature est l’art de savoir parler de notre histoire comme de l’histoire des autres et de l’histoire des autres comme de notre propre histoire. Pour arriver à ce but, nous commençons par lire les histoires et les livres des autres.
Mon père avait une bonne bibliothèque de quelque mille-cinq-cents livres qui aurait largement suffi à un écrivain. Quand j’avais vingt-deux ans, je n’avais peut-être pas lu tous les livres qui étaient dans sa bibliothèque, mais je les connaissais tous un par un, je savais lesquels étaient importants, lesquels étaient légers et faciles à lire, lesquels étaient des Classiques et des monuments incontournables, lesquels étaient des témoins, voués à l’oubli mais amusants, d’une histoire locale, et lesquels étaient les livres d’un écrivain français auxquels mon père tenait beaucoup. Parfois je contemplais de loin cette bibliothèque. J’imaginais que moi-même, un jour, j’allais, dans une autre maison, posséder une bibliothèque semblable et même meilleure, que j’allais me bâtir un monde avec des livres. Regardée de loin, la bibliothèque de mon père m’apparaissait parfois comme une image de tout l’univers. Mais c’était un monde que nous observions à partir d’un angle étroit, depuis Istanbul, et le contenu de la bibliothèque en témoignait aussi. Et mon père avait constitué cette bibliothèque à partir des livres qu’il avait acheté pendant ses voyages à l’étranger, surtout à Paris et en Amérique, de ceux qu’il avait achetés dans sa jeunesse chez les bouquinistes d’Istanbul qui vendaient de la littérature étrangère dans les années quarante et cinquante, et de ceux qu’il avait continué d’acquérir dans des librairies que je connais moi aussi. Mon monde est un mélange de local et de mondial, de national et d’occidental. A partir des années soixante-dix, moi aussi j’ai eu la prétention de me constituer une bibliothèque personnelle, avant même d’avoir vraiment décidé de devenir écrivain ; comme j’en parle dans mon livre Istanbul, je savais déjà que je ne deviendrais pas peintre non plus, mais je ne savais pas exactement quelle voie ma vie allait prendre. J’avais d’une part une curiosité insatiable et universelle, et une soif d’apprendre excessive et naïve. D’autre part je sentais que ma vie était vouée à rester insatisfaite, privée de certaines choses qui sont données aux autres. Ce sentiment relevait en partie de celui d’être loin du centre, en province, qui nous gagnait à force de vivre à Istanbul ou rien qu’à regarder la bibliothèque de mon père. Mon autre souci était que j’habitais en Turquie, dans un pays qui n’attache pas grande importance à ses artistes, qu’ils pratiquent la peinture ou la littérature, et les laisse vivre sans espoir. Dans les années soixante-dix, lorsque j’achetais, avec l’argent que mon père me donnait, des livres d’occasion, poussiéreux et usés, chez des bouquinistes d’Istanbul, comme par une ambition dérisoire de suppléer ce que la vie ne m’apportait pas, l’aspect misérable des vendeurs, dans les cours des mosquées, au pied des ruines, au coin des rues, la décrépitude et la pauvreté sordide de tous ces endroits désespérants, m’influençaient autant que le contenu des livres eux-mêmes.
Quant à ma place dans l’univers, mon sentiment était que de toute façon, j’étais à l’écart, et bien loin de tout centre, que ce soit dans la vie ou dans la littérature. Au centre du monde existait une vie plus riche et plus passionante que celle que nous vivions, et moi j’en étais exclu, à l’instar de tous mes compatriotes. Aujourd’hui, je pense que je partageais ce sentiment avec la presque totalité du monde. De la même façon, il y avait une littérature mondiale, dont le centre se trouvait très loin de moi. Mais ce à quoi je pensais, était non pas la littérature mondiale mais la littérature occidentale. Et nous les Turcs en étions bien sûr exclus aussi, comme le confirmait la bibliothèque de mon père. D’une part il y avait les livres et la littérature d’Istanbul, notre monde restreint dont j’affectionne depuis toujours et encore aujourd’hui les détails, et il y avait les livres du monde occidental, tout différents, qui nous donnaient autant de peine que d’espoir. Ecrire et lire étaient en quelque sorte une façon de sortir d’un monde et de trouver une consolation par l’intermédiaire de la différence, de l’étrangeté et des créations géniales de l’autre. Je sentais que mon père aussi lisait parfois pour échapper à son monde et fuir vers l’Occident, tout comme je l’ai fait moi-même plus tard. Il me paraissait aussi qu’à cette époque-là , les livres nous servaient à nous défaire du sentiment d’infériorité culturelle ; le fait de lire, mais aussi d’écrire nous rapprochait de l’Occident et en nous faisant partager quelque chose. Mon père, pour remplir tous ces cahiers dans cette valise était allé s’enfermer dans une chambre d’hôtel à Paris, et avait rapporté en Turquie ce qu’il avait écrit. Je sentais, en regardant la valise de mon père que moi aussi, j’étais concerné, et cela me terrifiait. Après vingt-cinq années passées, pour être écrivain en Turquie, dans la solitude d’une chambre, je me révoltais en regardant la valise de mon père contre le fait que le métier d’écrivain, le fait d’écrire sincèrement suppose qu’on l’exerce en cachette de la société, de l’Etat et de la Nation. C ‘est peut-être là mon principal ressentiment contre mon père : de n’avoir pas autant que moi pris le métier d’écrivain au sérieux. En fait, je lui en voulais de n’avoir pas mené la vie qui est la mienne, d’avoir choisi de vivre dans la société, avec ses amis, les gens qu’il aimait, sans s’exposer au moindre conflit pour quoi que ce soit. Mais en même temps, je savais ce que ces reproches recouvraient de jalousie, et que ce mot aurait été le plus exact pour décrire mon énervement. Je me demandais, comme une obsession, « qu’est-ce que le bonheur ? ». Est-ce croire vivre une vie profonde dans la solitude d’une chambre, ou est-ce vivre une vie facile au sein de la société, en croyant les mêmes choses que tout le monde ou en faisant semblant d’y croire. Est-ce qu’écrire en cachette de tous, dans son coin, tout en ayant l’air de vivre en harmonie avec tout le monde, était le bonheur, ou le malheur ? C’étaient-là des questions trop irritantes, trop brûlantes pour moi. De plus, d’où avais-je tiré que le bonheur fût le critère d’une vie réussie ? Les gens, les journaux, tout le monde se comportait comme si la vie se mesurait essentiellement au bonheur qu’elle offrait, et cela seul justifiait sans doute qu’on pût envisager le contraire. D’ailleurs, connaissant bien mon père, et cette façon qu’il avait eu de nous abandonner et de nous fuir constamment, j’étais aussi bien à même de percevoir son inquiétude profonde.
Voilà ce qui m’a fait ouvrir finalement la valise de mon père. Peut-être y avait-il dans sa vie un secret, un malheur trop important pour qu’il ait pu le supporter sans l’écrire. Dès que j’ai ouvert la valise, je me suis souvenu de l’odeur de son sac de voyage, et je me suis aperçu que je connaissais certains de ses cahiers, que mon père m’avait montré des années plus tôt, sans y attacher d’importance. La plupart de ceux que j’ai feuilletés un par un dataient des années où mon père, jeune encore, nous avait souvent quittés pour se rendre à Paris. Mais ce que j’aurais souhaité, moi, comme les écrivains que j’aime et dont je lis les livres, c’était apprendre ce que mon père avait pu penser et écrire au même âge que moi. Rapidement, j’ai compris que je n’allais pas faire cette expérience. J’étais gêné aussi par la voix d’écrivain que je percevais ça et là dans ces cahiers. Je me disais que cette voix n’était pas celle de mon père, qu’elle n’était pas authentique, ou bien que cette voix n’appartenait pas à la personne que je connaissais comme mon père. Il y avait ici une crainte plus grave que la simple inquiétude de découvrir que mon père cessait, en écrivant, d’être mon père : ma propre peur de ne pas réussir à être authentique l’emportait sur celle de ne pas apprécier ses écrits à lui, et de constater même qu’il était excessivement influencé par d’autres écrivains, et elle se transformait en une crise d’authenticité qui m’obligeait à m’interroger, comme dans ma jeunesse, sur mon existence entière, sur ma vie, mon envie d’écrire, et ce que j’ai écrit moi-même. Pendant les dix premières années où j’ai écrit des romans, j’éprouvais cette crainte avec acuité, elle m’accablait presque ; tout comme j’avais renoncé à peindre, j’avais peur que cette inquiétude me fasse renoncer à écrire.
Je vous ai déjà parlé des deux sentiments que cette valise – que j’ai depuis refermée et rangée – avaient suscités en moi : le sentiment de provincialité, et le souci d’authenticité. Bien évidemment, ce n’était pas la première fois que j’éprouvais profondément ces sentiments d’inquiétude. J’avais moi-même en lisant et en écrivant exploré, découvert et approfondi pendant des années ces sentiments à ma table de travail, dans toute leur ampleur, avec leurs conséquences, leurs interconnections, leurs intrications et la diversité de leurs nuances. Bien sûr, je les avais éprouvés maintes fois, surtout dans ma jeunesse, douleurs diffuses, susceptibilités lancinantes, désordres de l’esprit dont la vie et les livres ne cessaient pas de m’affliger. Mais je n’étais parvenu au fond du sentiment d’être provincial, de l’angoisse de n’être pas authentique qu’en écrivant des romans, des livres là-dessus (par exemple Neige ou Istanbul pour le sentiment de provincialité, ou Mon Nom est Rouge et Le Livre noir pour le souci d’authenticité). Pour moi, être écrivain, c’est appuyer sur les blessures secrètes que nous portons en nous, que nous savons que nous portons en nous – les découvrir patiemment, les connaître, les révéler au grand jour, et faire de ces blessures et de nos douleurs une partie de notre écriture et de notre identité.
Etre écrivain, c’est parler des choses que tout le monde sait sans en avoir conscience. La découverte de ce savoir et son partage donnent au lecteur le plaisir de parcourir en s’étonnant un monde familier. Nous prenons sans doute aussi ce plaisir au talent qui exprime par des mots ce que nous connaissons de la réalité. L ‘écrivain qui s’enferme dans une chambre et développe son talent pendant des années, et qui essaie de construire un monde en commençant par ses propres blessures secrètes, consciemment ou inconsciemment, montre une confiance profonde en l’humanité. J’ai toujours eu cette confiance en ce que les autres aussi portent aussi ce genre de blessures, en ce que les êtres humains se ressemblent. Toute la littérature véritable repose sur une confiance – d’un optimisme enfantin – selon laquelle les hommes se ressemblent. Quelqu’un qui écrit pendant des années enfermé s’adresse à cette humanité et à un monde sans centre.
Mais comme on peut le comprendre de la valise de mon père et des couleurs fânées de la vie que nous menions à Istanbul, le monde avait un centre bien loin de nous. J’ai beaucoup parlé de ce sentiment tchekhovien de provincialité et de l’angoisse d’authenticité inspiré tous deux par l’expérience de cette vérité fondamentale. Je connais par moi-même que la majorité écrasante de la population mondiale vit avec ces sentiments oppressants en luttant contre le manque de confiance en soi et contre la peur de l’humiliation. Oui, le souci principal de l’humanité est encore la pauvreté, le manque de nourriture, de logement… Mais désormais, les télévisions, les journaux nous racontent ces problèmes fondamentaux plus rapidement et plus facilement que la littérature. Si ce que la littérature doit raconter et explorer aujourd’hui c’est le problème principal de l’humanité, la peur de l’exclusion et de se sentir sans importance, le sentimment de ne rien valoir, les atteintes à l’amour propre éprouvées par les sociétés, les fragilités, la crainte de l’humiliation, les colères de tout ordre, les susceptibilités, et les vantardises nationales… Je peux comprendre ces paranoïas, qui sont le plus souvent exprimées dans un langage irrationnel et excessivement sensible, chaque fois que je fixe l’obscurité qui est en moi. Nous témoignons de ce que les grandes foules, les sociétés et les nations constituant le monde en dehors de l’Occident, auxquelles je m’identifie facilement, sont imprégnées de peurs qui frisent parfois la stupidité, à cause de cette peur d’être humilié et de cette susceptibilité. Je sais en même temps que les nations, les Etats dans le monde occidental, auquel je peux tout aussi facilement m’identifier, sont parfois imbus d’un orgueil (vanité d’avoir produit la Renaissance, les Lumières, la Modernité, la société d’abondance) qui frise tout autant la stupidité.
En conséquence, non seulement mon père, mais nous tous surestimons l’idée selon laquelle le monde aurait un centre. Cependant, ce qui nous tient enfermés dans une chambre pendant des années pour écrire est une confiance contraire ; c’est une foi en ce qu’un jour, ce que nous avons écrit sera lu et compris car les hommes se ressemblent partout dans le monde. Mais, je le sais par moi-même et par ce que mon père a écrit, ceci est d’un optimisme inquiet, blessé, inspiré par la peur d’être en marge, en dehors. J’ai senti maintes fois en moi-même les sentiments d’amour et de haine que Dostoïevski a éprouvés toute sa vie à l’égard de l’Occident. Mais ce que j’ai vraiment appris de lui, ma vraie source d’optimisme, c’est le monde complètement différent que ce grand écrivain a fondé en partant de sa relation d’amour et de haine avec l’Occident mais en la dépassant.
Tous les écrivains qui ont consacré leur vie à ce métier savent cette réalité : les motifs qui nous ont amenés à écrire et le monde que nous avons construit à force d’écrire pendant des années avec espoir se posent finalement dans des lieux différents. De la table où nous étions assis avec notre chagrin ou notre colère, nous sommes arrivés à un monde entièrement différent, au-delà de ce chagrin et de cette colère. N’était-il pas possible que mon père, lui aussi, eût atteint un tel monde ? Ce monde auquel on arrive au bout d’un long voyage, nous inspire un sentiment de miracle, tout comme une île qui apparaît peu à peu devant nous, dans toutes ses couleurs, lorsque le brouillard se lève sur la mer. Ou bien cela ressemble à ce qu’ont ressenti les voyageurs occidentaux à l’approche d’Istanbul, par la mer, quand elle émerge du brouillard de l’aube. A la fin du long voyage commencé avec espoir et curiosité, il existe une ville, un monde entier avec ses mosquées, ses minarets, ses maisons, ses rues en pente, ses collines, ses ponts. On a envie d’entrer de plain pied dans ce monde, et de s’y perdre, tout comme un bon lecteur se perd dans les pages d’un livre. Nous étions assis à cette table, en colère, tristes, et nous avons découvert un nouveau monde qui nous a fait oublier ces sentiments.
Contrairement à ce que je ressentais pendant mon enfance et ma jeunesse, le centre du monde pour moi est désormais Istanbul. Non seulement parce que j’y ai passé presque toute ma vie, mais aussi parce que depuis trente-trois ans, j’ai raconté ses rues, ses ponts, ses humains et ces chiens, ses maisons et ses mosquées, ses fontaines, ses héros étonnants, ses magasins, ses petits gens, ses recoins sombres, ses nuits et ses jours, en m’identifiant à chacun tour à tour. A partir d’un certain moment, ce monde que j’ai imaginé échappe aussi à mon contrôle et devient plus réel dans ma tête que la ville dans laquelle je vis. Alors, tous ces hommes et ces rues, ces objets et ces bâtiments commencent en quelque sorte à parler entre eux, à établir entre eux des relations que je ne pouvais pas pressentir, à vivre par eux-mêmes, et non plus dans mon imagination et mes livres. Ce monde que j’ai construit en l’imaginant patiemment, comme on creuse un puits avec une aiguille, m’apparaît alors plus réel que tout.
En regardant sa valise, je me disais que peut-être mon père aussi avait connu ce bonheur réservé aux écrivains qui ont voué tant d’années à leur métier, et que je ne devais pas avoir de préjugés à son égard. Par ailleurs, je lui étais reconnaissant de n’avoir pas été un père ordinaire, distribuant des ordres et des interdictions, qui écrase et punit, et de m’avoir toujours respecté et laissé libre. J’ai parfois cru que mon imagination pouvait fonctionner librement comme celle d’un enfant, parce que je ne connaissais pas la peur de perdre, contrairement à de nombreux amis de mon enfance et de ma jeunesse, et j’ai parfois sincèrement pensé que je pouvais devenir écrivain parce que mon père a voulu devenir lui-même écrivain dans sa jeunesse. Je devais le lire avec tolérance et comprendre ce qu’il avait écrit dans ces chambres d’hôtel.
Avec ces pensées optimistes, j’ai ouvert la valise, qui était restée plusieurs jours là où mon père l’avait laissée, et j’ai lu, en mobilisant toute ma volonté, certains cahiers, certaines pages. Qu’avait-il donc écrit ? Je me souviens de vues d’hôtels parisiens, de quelques poèmes, de paradoxes, de raisonnements… Je me sens maintenant comme quelqu’un qui se rappelle difficilement, après un accident de voiture, ce qui lui est arrivé, et qui rechigne à se souvenir. Lorsque dans mon enfance ma mère et mon père étaient sur le point de commencer une dispute, c’est-à-dire lors de l’un de leurs silences mortels, mon père allumait tout de suite la radio, pour changer l’ambiance, la musique nous faisait oublier plus vite.
Changeons de sujet, et disons quelques mots « en guise de musique ». Comme vous le savez, la question la plus fréquemment posée aux écrivains est la suivante : « Pourquoi écrivez-vous ? » J’écris parce que j’en ai envie. J’écris parce que je ne peux pas faire comme les autres un travail normal. J’écris pour que des livres comme les miens soient écrits et que je les lise. J’écris parce que je suis très fâché contre vous tous, contre tout le monde. J’écris parce qu’il me plaît de rester enfermé dans une chambre, à longueur de journée. J’écris parce que je ne peux supporter la réalité qu’en la modifiant. J ‘écris pour que le monde entier sache quel genre de vie nous avons vécu, nous vivons moi, les autres, nous tous, à Istanbul, en Turquie. J’écris parce que j’aime l’odeur du papier et de l’encre. J’écris parce que je crois par-dessus tout à la littérature, à l’art du roman. J’écris parce que c’est une habitude et une passion. J’écris parce que j’ai peur d’être oublié. J’écris parce que je me plaîs à la célébrité et à l’intérêt que cela m’apporte. J’écris pour être seul. J’écris dans l’espoir de comprendre pourquoi je suis à ce point fâché avec vous tous, avec tout le monde. J’écris parce qu’il me plaît d’être lu. J’écris en me disant qu’il faut que je finisse ce roman, cette page que j’ai commencée. J’écris en me disant que c’est ce à quoi tout le monde s’attend de ma part. J’écris parce que je crois comme un enfant à l’immortalité des bibliothèques et à la place qu’y tiendront mes livres. J’écris parce que la vie, le monde, tout est incroyablement beau et étonnant. J’écris parce qu’il est plaisant de traduire en mot toute cette beauté et la richesse de la vie. J ‘écris non pas pour raconter des histoires, mais pour construire des histoires. J’écris pour échapper au sentiment de ne pouvoir atteindre un lieu où l’on aspire, comme dans les rêves. J’écris parce que je n’arrive pas à être heureux, quoi que je fasse. J’écris pour être heureux.
Une semaine après avoir déposé la valise dans mon bureau, mon père m’a rendu visite à nouveau, avec comme d’habitude un paquet de chocolats (il oubliait que j’avais quarante-huit ans). Comme d’habitude nous avons parlé de la vie, de politique, des potins de famille et nous avons ri. A un moment donné, mon père a posé son regard là où il avait laissé la valise, et il a compris que je l’avais enlevée. Nos regards se sont croisés. Il y a eu un silence embarrassé. Je ne lui ai pas dit que j’avais ouvert la valise et essayé d’en lire le contenu. J’ai fui son regard. Mais il a compris. Et j’ai compris qu’il avait compris. Et il a compris que j’avais compris qu’il avait compris. Ce genre d’intercompréhension ne dure que le temps qu’elle dure. Car mon père était un homme sûr de lui, à l’aise et heureux avec lui-même. Il a ri comme d’habitude, Et en partant, il a encore répété, comme un père, les douces paroles d’encouragement qu’il me disait toujours.
Comme d’habitude, j’ai l’ai regardé sortir en enviant son bonheur, sa tranquillité, mais je me souviens que ce jour-là j’ai senti en moi un tressaillement embarrassant de bonheur. Je ne suis peut-être pas aussi à l’aise que lui, je n’ai pas mené une vie heureuse et sans problèmes comme lui, mais j’avais, comme vous l’avez compris, remis ses écrits à leur place… J’avais honte d’avoir éprouvé cela envers mon père. De plus mon père loin d’avoir été un centre, m’avait laissé libre de ma vie. Tout cela doit nous rappeler que le fait d’écrire et la littérature sont profondément liés à un manque autour duquel tourne notre vie, au sentiment de bonheur et de culpabilité.
Mais mon histoire a une autre moitié, symétrique, qui m’a inspiré encore plus de culpabilité, et dont je me suis souvenu ce jour-là. Vingt-trois ans auparavant, quand j’avais vingt-deux ans, j’avais décidé de tout abandonner et de devenir romancier, je m’étais enfermé dans une chambre, et quatre ans plus tard, j’avais terminé mon premier roman, Monsieur Djevdet et ses fils, et j’avais remis, les mains tremblantes, une copie dactylographiée du livre qui n’était pas encore publié, à mon père, pour qu’il le lise et me dise ce qu’il en pensait. Obtenir son approbation était pour moi important, non seulement parce que je comptais sur son goût et sur son intelligence, mais aussi parce que contrairement à ma mère, mon père ne s’opposait pas à ce que je devienne écrivain. A cette époque là, mon père n’étais pas avec nous. Il était loin. J’attendis impatiemment son retour. Quand il est rentré, deux semaines après, j’ai couru lui ouvrir la porte. Mon père n’a rien dit, mais il m’a pris dans ces bras, embrassé d’une façon telle que j’ai compris qu’il avait beaucoup aimé mon livre. Pendant un certain temps, nous sommes restés silencieux, mal à l’aise, comme il arrive dans des moments de sentimentalité excessive. Lorsqu’un peu plus tard nous nous sommes mis un peu plus à l’aise, et avons commencé à causer, mon père a exprimé, d’une façon excessivement excitée et par des mots exagérés, sa confiance en moi, et en mon premier livre, et il m’a dit que j’allais un jour recevoir ce prix, que j’accepterais aujourd’hui avec beaucoup de bonheur.
Il m’avait dit cela moins par conviction ou avec l’intention de m’assigner un but, que comme un père turc dit à son fils, pour l’encourager « Tu seras un pacha ». Et il a répété ces paroles pendant des années, à chaque fois qu’il me voyait, pour me donner du courage.
Mon père est mort en décembre 2002.
Honorables membres de l’académie suédoise qui m’avez accordé ce grand prix, cet honneur, et vous leurs éminents invités, j’aurais beaucoup aimé que mon père soit parmis nous aujourd’hui.
Traduction de la langue turque par Gilles Authier
Nobel Prizes and laureates
See them all presented here.